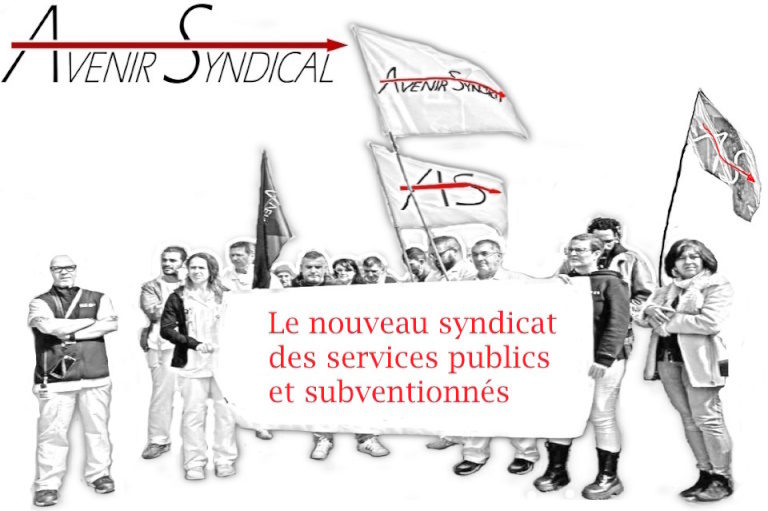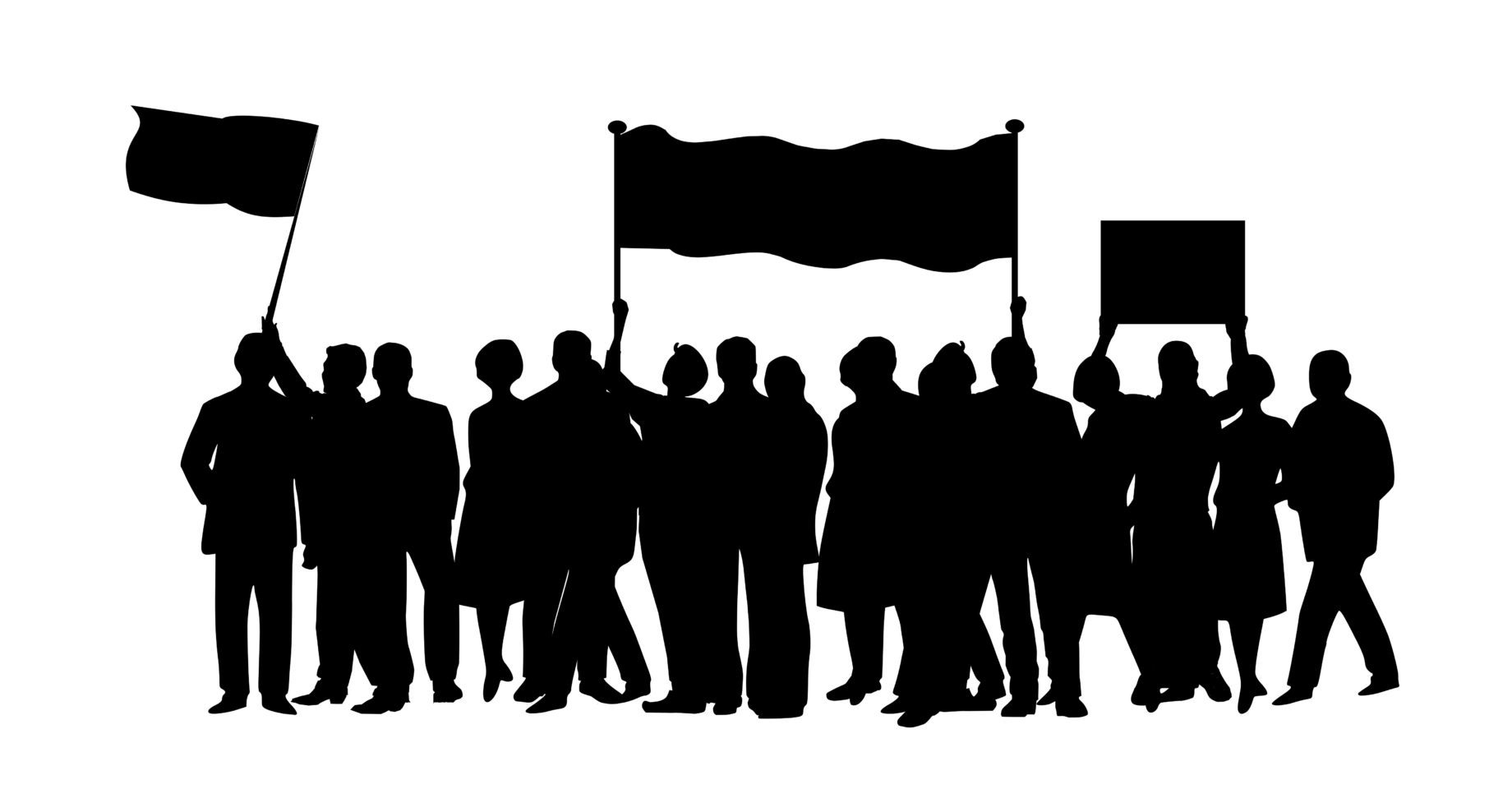Le projet de nouvelle directive sur le temps de travail des enseignants va à l’encontre du bien-être à l’école des enseignant.es et par incidence sur celui des élèves. Cette fois-ci, même les plus pondérés des enseignant.es seront certainement dans la rue, toutes et tous se mobilisent, mais pourquoi ?
Tout d’abord parce que les associations et syndicats n’ont pas été entendus lors de la commission du statut et que la présentation de ladite directive, début février, n’avait pas pour objet, de la part de nos autorités, la discussion. Dans une telle situation, seul le recours à la manifestation dans un premier temps et à la grève dans un deuxième temps reste les outils qui doivent ouvrir sur un dialogue entre employeur et enseignant.es.
Les trois ordres d’enseignement : le primaire, le secondaire I (CO), le secondaire II (post-obligatoire) sont solidaires pour dire que l’attention à l’élève sera diminuée, alors que nous savons que la sortie du Covid et l’inclusion ont nécessité d’œuvrer pour soutenir nos enfants et nos jeunes. Les hôpitaux et les reportages de la RTS l’attestent.
Les mesures prises dans la directive du temps de travail des enseignants sont la non-reconnaissance de toutes les tâches faites en dehors du temps d’enseignement, de sa préparation, de ses évaluations et des corrections. C’est un point de vue réducteur du travail de l’enseignant.e, qui d’ailleurs est souvent méconnu du grand public, mais semble l’être aussi de nos nouvelles autorités. Les enseignant.es craignent que les premiers prétérités de cette baisse de prestation soient les élèves pour lesquels le temps qui leur sera consacré diminuera, ce qui pose un réel souci pour les générations d’étudiants à venir.
Rappelons que le personnel enseignant ne dispose pas du même temps de vacances que les élèves et qu’il travaille très largement les 1800 heures annuelles représentant le cadre administratif de la fonction publique.
Les sondages effectués par les organismes de statistique comme le SRED, et aussi la dernière enquête faite sur le bien-être au travail en 2024 dénoncent la surcharge du travail administratif qui prétérite la tâche primordiale qui est le suivi des élèves, alors que justement ce sont eux qui ont besoin du soutien des professeur.es.
Les charges administratives se déclinent sous de nombreuses facettes : cela va de la consultation des mails, aux multiples séances- conférences des maîtres, au rapports divers, aux documents adressés au parents, aux liens autour de la direction et du réseau, au suivi de travaux certificatifs, au travail de transversalité avec les collègues : conseils et préparation des programmes….
Si tout ce travail est déjà peu reconnu et rémunéré par des indemnités ou des heures aux cachets (sans cotisation LPP et sans annuité), faire glisser ces heures dans un trou noir non identifié, comme c’est prévu dans le projet de directive sur le temps de travail, c’est occulter le temps de travail conséquent des enseignant.es autour des enfants et des jeunes. Comme le corps enseignant travaille déjà le soir ou très tôt le matin et le week-end et fait en général plus de 46 heures hebdomadaires, il deviendra donc impossible de bénéficier d’assez d’attention sur les différentes problématiques des élèves et ce sont ceux-ci qui en pâtiront. Ce qui est d’autant plus mesquin à la lecture du projet de la directive, c’est qu’il est précisé que c’est de la responsabilité de l’enseignant.e de veiller à maintenir des moments de déconnexion avec son travail.
Au vu de ce qui est mentionné plus haut, le projet de Directive sur le temps de travail ne répond pas à la situation vécue par les enseignant.es sur le terrain. Les trois ordres d’enseignement demandent que l’élève soit au centre, et pour cela que les enseignant.es puissent consacrer du temps pour chacun d’entre eux. Il apparaît que le travail effectué par le corps enseignant soit méconnu, or ne pas le prendre en compte dans la directive, c’est impacter le suivi des élèves, leur accompagnement sur leur chemin d’étudiant et sur le parcours de leur formation.